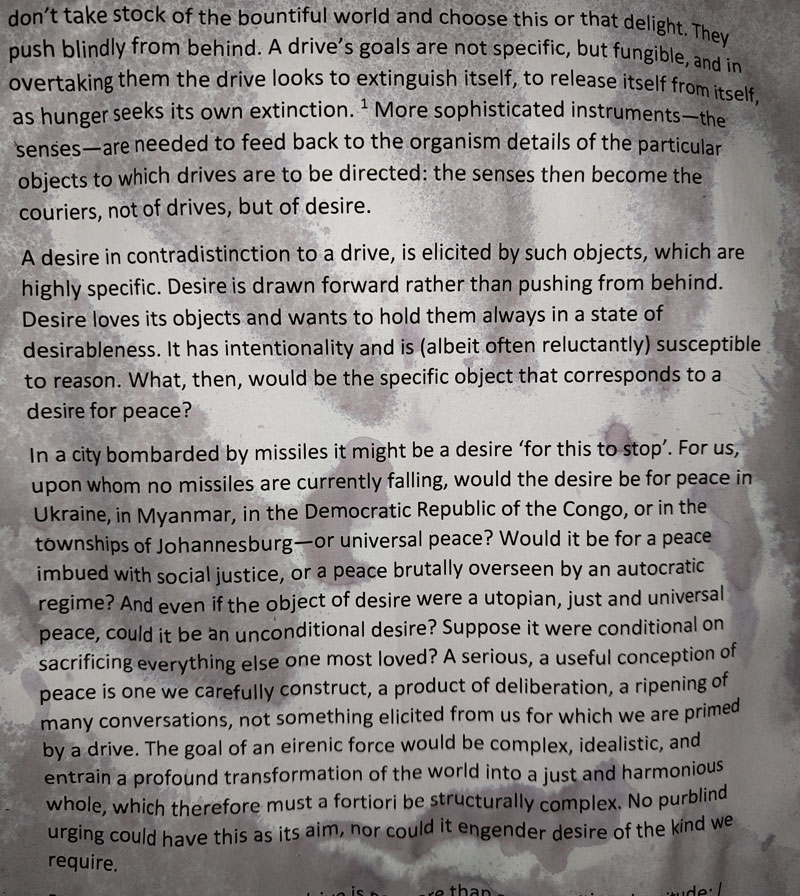Unleash your Peace

Qui sommes-nous ?
Ce que nous sommes et ce que nous faisons
Dans une pyramide de catégories descriptives, nous sommes, au niveau de la base, des organismes eucaryotes multicellulaires, et plus haut, des mammifères vertébrés. À mesure que l’on remonte dans la hiérarchie taxonomique, apparaissent des termes qui nous identifient spécifiquement : mammifères bipèdes obligatoires, homo sapiens. Bien qu’ils distinguent les êtres humains des autres organismes, ces termes sont cependant décevants, ne disant pas grand-chose de nous.
Si nous poursuivons notre ascension, laissant derrière nous les étiquettes taxonomiques, nous atteignons le point culminant, ou pyramidion. Biologiquement, il est minuscule. Après tout, nous partageons 99 % de notre ADN avec les bonobos (mais aussi 90 % avec les chats et 60 % avec les bananes). On pourrait s’attendre à ce qu’il soit colossal, qu’il abonde d’une infinité de façons de nous décrire. Il n’en est rien. Le modèle pyramidal vaut uniquement pour la taxonomie biologique, et la notion d’homo sapiens en constitue le sommet. C’est comme si, à un moment donné de notre développement, une seconde pyramide, celle-ci inversée, s’était encastrée dans la première, venant former un sablier qui s’élargit vers le haut ; un entonnoir vacillant qui est empli (et qui continue de s’emplir) de tentatives d’exprimer tout ce qu’il est possible de dire sur nous : art pariétal (nous y sommes !), musique, religion, poèmes, philosophie, théâtre, sciences humaines et sociales, romans, essais…
Parmi ces tentatives extrêmement variées, on retrouve plusieurs définitions accrocheuses : le zoon politikon d’Aristote, l’« animal rieur » de Thomas Willis, l’animal laborans de Marx, l’homo faber d’Hannah Arendt, l’homo documentator de Suzanne Briet ; ce qu’il y a de commun dans ce que nous faisons est incomparablement plus éclairant que ce que nous sommes d’un point de vue organique. Des définitions de ce type – et elles sont nombreuses – renvoient, avec plus ou moins de sérieux, à une nature essentielle. Mais, comme nous l’avons vu, il n’existe aucun sommet où viendrait se concentrer l’essence de l’humanité. Aucune cime de l’humanité. Aucun modèle humain parfait. La perfection implique la complétude, mais en ce qui nous concerne, c’est notre activité qui donne forme à ce que nous sommes. Et puisque nous pouvons seulement deviner ce que les humains seront capables de faire à terme, notre future nature demeure pour toujours une aspiration. Mais il y a des choses que nous, artisans de nous-mêmes, sommes déjà en mesure de faire : choisir de rendre le monde moins cruel, plus éclairé et plus juste ; des objectifs qui ne sont pas tirés d’une liste, mais qui viennent des profondeurs de l’entonnoir et que nous portons avec nous depuis les temps où le progrès humain et la survie étaient indissociables.
Comme tous nos choix puissants et créatifs, ces objectifs sont voués à être la source de leur propre renouvellement : nous les concevons en anticipant d’y revenir pour nous en inspirer. Si nous mettons dans ces choix autant d’application et de passion, c’est précisément pour que, lorsque nous les réévaluerons (face à l’évolution des circonstances, à des épreuves vécues par d’autres et du fait de notre propre réflexivité), ils revitalisent notre engagement à l’égard de leurs conséquences. Notre capacité unique à faire cela, à tenir fermement ce cercle, est une autre façon de définir les êtres humains.
Mais assez parlé de nous…
Qui suis-je ?
Je suis Mark-Alec Mellor, fondateur de Cadenza Academic Translations, où j’exerce comme éditeur. Je vis à Exeter, au Royaume-Uni, avec ma compagne et un chien. Mes principaux centres d’intérêt intellectuels sont l’éthique, la capacité d’action de l’humain, l’histoire des idées, la théorie de la traduction et les sciences cognitives.
Notre mission
Les appels à la paix en Ukraine, ou dans n’importe quelle zone infectée par la guerre, viennent contrebalancer les cabrioles furibondes de certains dirigeants mondiaux et cercles médiatiques. Mais il ne suffit pas d’exiger la fin de la guerre. Si l’on ne définit pas la paix indépendamment de la guerre, alors elle n’est rien d’autre qu’une trêve.
Nous commençons par conceptualiser la paix comme une force à exercer. Penser la paix uniquement comme un état de non-guerre, c’est la condamner à être pour toujours un objectif situé juste après la prochaine guerre. Faisons de la paix une force, pas un objectif. Comme le plaisir, la paix ne peut être dissociée des circonstances de sa jouissance : le plaisir de se promener dans un pré ou d’écouter de la musique ne peut être isolé et synthétisé. La paix sans justice ni bonté est une coquille vide.
Notre initiative à but non lucratif interroge la nature de la paix et examine comment des individus, des groupes, des dirigeants, des institutions et des sociétés peuvent déployer une force irénique. Qu’elle soit individuelle ou collective, l’activité la plus efficace est le travail, défini dans son acception la plus large. Notre objectif est de prendre conscience et de promouvoir la force irénique à l’œuvre dans le travail ; d’inciter et d’encourager chacun à participer au dialogue sur la meilleure façon de déployer ce pouvoir spécifiquement humain.